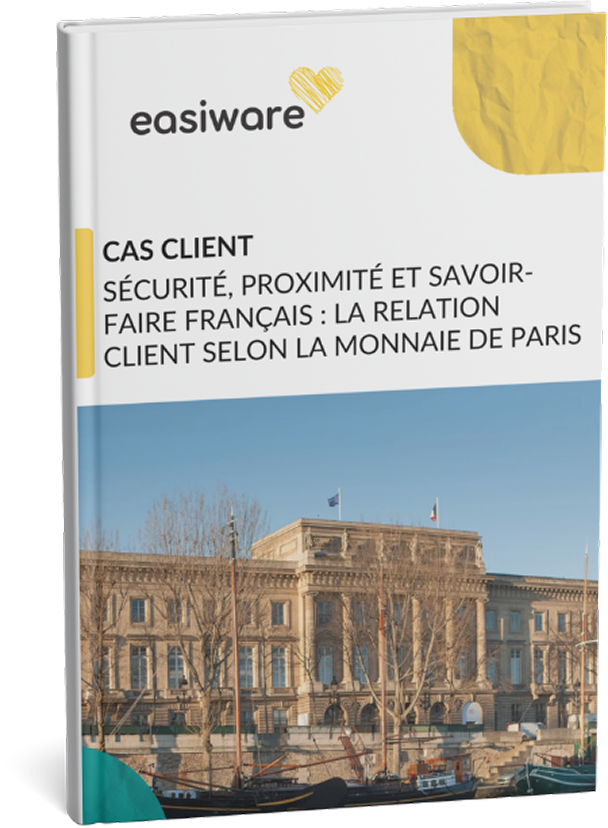Moderniser la relation usager : le grand chantier du service public

Alors que beaucoup d’efforts sont mis dans la transformation numérique, la modernisation du service public doit aussi passer par la mise au goût du jour de la relation usager, qui fait office d’enjeu prépondérant pour garantir l’efficacité, la légitimité et l’attractivité des institutions publiques. Celle-ci, parallèlement à la relation client, doit être envisagée comme une expérience globale, personnalisée et omnicanale, qui permet de répondre aux besoins spécifiques de chacun tout en garantissant équité et accessibilité.
Aussi vaste qu’urgent, ce grand chantier fait entrer en compte de nombreux facteurs, et implique à la fois une réforme des process, une évolution des postures professionnelles, ainsi qu’une transformation des outils numériques. Pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de la modernisation du service public, tout ce qu’il faut savoir est à retrouver dans ce dossier.
1. État des lieux et enjeux de la relation usager
A. Évolution des attentes et transformation des services publics
À mesure que le numérique est devenu omniprésent ces dernières années, les attentes des usagers ont elles aussi significativement évolué. Habitués à des expériences agréables, personnalisées, et souvent même instantanées dans le secteur privé, les citoyens attendent aujourd’hui des services publics qu’ils leur garantissent le même niveau d’efficacité et de qualité relationnelle.
La montée en puissance des exigences en matière d’accessibilité et de simplicité a poussé l’État à prendre des initiatives. Le programme « Services Publics+ » formalise justement des engagements concrets, avec notamment le respect mutuel, le droit à l’erreur, l’accessibilité multicanale, l’accompagnement personnalisé et la valorisation des retours d’expérience des usagers. Ces principes soutiennent l’établissement d’une relation usager basée sur la confiance, la transparence et la bienveillance.
Cette dynamique doit également induire la dimension humaine des interactions entre administrations et usagers. L’accueil, le ton ou encore la posture des agents influent directement sur la manière dont le service est perçu, une relation usager de qualité nécessitant une écoute active, de la clarté, et de la courtoisie. Les agents sont ainsi formés à la gestion des incivilités et au respect du droit à l’erreur.
La technologie vient en soutien de cette transformation, avec des acteurs publics comme France Travail qui expérimentent l’usage de modules de formation intégrant l’IA pour améliorer les postures d’accueil. Ces outils permettent de repérer et de réduire les irritants, c’est-à-dire les points de friction qui altèrent l’expérience usager. L’intelligence artificielle contribue ici à l’amélioration de la relation usager sans pour autant déshumaniser les échanges.
B. Les défis de la relation usager
Les attentes des citoyens envers les services publics sont donc de plus en plus prégnantes, mais leur satisfaction reste pourtant fragile. De nombreux obstacles subsistent pour que la relation usager soit aussi fluide, inclusive et efficace qu’elle devrait l’être, et ce à cause de défis technologiques, organisationnels et humains qui nécessitent une réponse systémique.
Le premier frein à la modernisation est la fracture numérique, car une part importante de la population ne maîtrise pas les outils digitaux, ou ne les considère pas comme un canal d’accès privilégié. La numérisation des services publics n’a en effet pas suffi à réformer en profondeur leur organisation. Pour que la transformation porte ses fruits, il est indispensable d’accompagner les usagers en difficulté, de garantir la sécurité des données, et de développer la confiance envers les services dématérialisés.
La complexité des démarches administratives constitue un autre défi récurrent. La multiplication des formulaires, des plateformes ou des étapes nécessaires à la résolution d’un besoin génère confusion et découragement, ce qui affecte l’expérience usager et alimente un sentiment d’inefficacité. Pour y remédier, les administrations doivent repenser leurs parcours, mieux orienter les usagers dès le premier contact, et rendre leurs services plus lisibles et accessibles.
La confiance est quant à elle mise à mal par des règles qui peuvent être vues comme trop rigides ou punitives. Le respect du droit à l’erreur, inscrit dans la loi ESSOC, a justement pour but d’inverser cette logique, car l’usager doit être présumé de bonne foi, pouvoir corriger ses erreurs sans craindre une sanction immédiate, et recevoir des informations claires et pédagogiques. Cette bienveillance institutionnelle est le socle d’une relation plus apaisée et constructive avec les usagers.
C. Bases légales et éthiques
La modernisation de la relation usager dans le secteur public passe impérativement par l’instauration et le respect d’un cadre réglementaire clair et de principes éthiques. Les bases qui sont ainsi posées garantissent la conformité des actions qui sont entreprises, et servent de terreau propice au développement de la confiance des citoyens.
Plusieurs textes législatifs encadrent la gestion de la relation usager :
- La loi NOTRe (2015) a redéfini l’organisation territoriale pour favoriser une meilleure répartition des compétences ;
- La loi pour une République numérique (2016) a posé les bases de la transition digitale des administrations ;
- La loi n° 2000‑321, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, renforce l’accès à l’information et aux documents administratifs.
Sur le plan de la protection des données, la réglementation européenne est parmi les plus exigeantes. Le RGPD définit la manière dont les données personnelles des usagers sont collectées, stockées et utilisées. Il impose notamment des principes de Privacy by Design, et un hébergement des données au sein de l’Union européenne.
Comme évoqué précédemment, la loi ESSOC incite pour sa part les administrations à faire preuve de pédagogie et de bienveillance, à informer clairement sur les démarches qui sont à réaliser, et à créer des conditions favorables à un dialogue constructif. La charte de bienveillance qui est associée à cette loi contribue à l’instauration d’une relation plus équilibrée, au sein de laquelle l’usager est perçu comme un partenaire légitime du service public.
2. Solutions et outils pour moderniser la relation usager
A. Gestion de la Relation Usager (GRU) et services omnicanaux
La transformation et la modernisation de la relation usager obligent à la mise en place d’une stratégie multicanale, qui est soutenue par la Gestion de la Relation Usager (GRU). Inspirée des pratiques qui sont issues du secteur privé, cette approche permet d’améliorer l’expérience citoyenne tout en renforçant l’agilité et l’efficience des services publics.
Les trois piliers fondamentaux de la GRU sont :
- Une expérience fluide et une centralisation des données et interactions, qui permettent d’avoir une vue globale des échanges et des besoins des usagers pour mieux comprendre leurs attentes, et y répondre de manière cohérente quel que soit le canal de communication utilisé ;
- Une stratégie omnicanale et personnalisée, qui offre aux citoyens la possibilité d’interagir selon leurs préférences, à tout moment et sur tous les supports, pour que la continuité de service, l’accessibilité et l’équité soient garanties ;
- Une amélioration continue de la qualité de service, la GRU facilitant l’analyse des interactions, l’identification des points de friction, et l’adaptation des parcours usagers en temps réel, ce qui en fait une solution de pilotage au service des performances des services publics.
L’essor des téléservices accompagne cette logique de modernisation. Inscriptions scolaires, demandes d’actes, prises de rendez-vous ou paiements peuvent désormais se faire en ligne, à toute heure, et sans déplacement. Pour que ces services soient conformes aux attentes, ils doivent être :
- Accessibles 24h/24 et 7 j/7 ;
- Compatibles avec tous les supports (ordinateurs, tablettes, smartphones) ;
- Connectés aux systèmes d’information pour éviter les ruptures dans les parcours usagers, et garantir un suivi efficace et transparent ;
- Inclusifs, c’est-à-dire pensés pour tous les publics, y compris les personnes en situation de handicap ou peu familières avec le numérique.
La centralisation des données via un référentiel usager unique permet enfin d’éviter les ressaisies, et de fluidifier les démarches. Cette approche, combinée à l’urbanisation des systèmes d’information (interopérabilité, API, web services), améliore durablement la réactivité des services et favorise l’innovation, tout en respectant les exigences en matière de sécurité et de protection des données.
B. Technologies innovantes : IA, chatbots et simulations
L’intégration de technologies innovantes s’avère essentielle pour soutenir la modernisation de la relation usager dans les services publics. En facilitant l’accès à l’information, en automatisant les réponses courantes et en accompagnant les agents dans leurs missions, des outils comme l’intelligence artificielle, les chatbots ou les simulateurs immersifs contribuent à l’amélioration significative de l’expérience usager.
Les agents conversationnels (chatbots) et les assistants virtuels sont parmi les dispositifs les plus répandus, ceux-ci étant disponibles en continu, et permettant de traiter en très peu de temps un grand nombre de demandes récurrentes. Certaines plateformes disposent d’ailleurs de fonctionnalités de compréhension du langage naturel qui garantissent des réponses précises, aident à réduire les temps d’attente, et orientent les usagers de manière proactive.
L’IA sert également à analyser les interactions, à identifier les points de friction, à anticiper les besoins, et à adapter les process en continu. Elle déleste ainsi les agents publics des cas simples et répétitifs pour qu’ils se concentrent sur des situations plus complexes, qui nécessitent un accompagnement humain et personnalisé.
Les technologies immersives complètent ce dispositif, notamment avec des modules de formation innovants. Des administrations comme la DITP ou France Travail ont recours à des simulateurs IA intégrant des avatars interactifs pour entraîner les agents, par exemple en ce qui concerne les postures d’accueil à adopter. Ces simulations reproduisent des situations concrètes de dialogue avec les usagers, et se focalisent sur des éléments comme le ton, la gestuelle, l’écoute active et la gestion des émotions.
Ces différents outils participent
- Au renforcement des compétences relationnelles des agents ;
- À la réduction des irritants en amont des interactions physiques ou téléphoniques ;
- À l’amélioration de l’orientation des usagers dès le premier contact ;
- À l’uniformisation de la qualité d’accueil sur l’ensemble du territoire.
Loin de remplacer l’humain, ces technologies le renforcent dans son rôle et dans ses missions d’écoute, d’accompagnement, et de résolution des situations complexes. Elles favorisent une approche équilibrée de la modernisation de la relation usager, qui allie innovation et qualité de service.
3. Mise en œuvre et accompagnement pour réussir la modernisation
A. Préparation et co‑construction des services
Comme pour tout projet de transformation, la phase préparatoire est une étape clé de réussite. Il est nécessaire que le programme de modernisation qui est mis en place soit structuré, construit en collaboration avec toutes les parties prenantes, et aligné avec les besoins des usagers dès son ébauche. Le principe de user-centric design, de plus en plus mis en avant au sein des administrations, a pour objectif de replacer le citoyen au centre des démarches de service public.
La co-construction revêt une importance capitale dans cette logique. Recommandée par la DINSIC (Direction interministérielle du numérique), elle implique une collaboration active entre les agents, les usagers et les partenaires institutionnels pour concevoir des services pertinents, accessibles, et facilement utilisables. Par ce biais, les risques d’inadéquation entre les outils mis en place et les attentes réelles sont significativement réduits.
Il est par ailleurs à noter que l’amélioration de la relation usager est une vraie priorité stratégique pour la majorité des décideurs publics. Le numérique et l’innovation sont valorisés en raison de leur rôle clé pour adapter l’offre de service, optimiser les parcours usagers, et simplifier les démarches.
Une planification rigoureuse s’impose donc pour assurer la cohérence et la pérennité des actions engagées, avec la définition d’une feuille de route claire et une analyse minutieuse des besoins des usagers. Le choix de la plateforme GRU doit pour cela répondre à plusieurs critères, notamment la sécurité, l’interopérabilité, la sobriété et le respect des valeurs humaines, en veillant par là même à ce que celle-ci soit adaptée à l’écosystème existant (infrastructures, systèmes d’information, ressources internes).
Cette exigence de développement technologique pérenne s’inscrit dans une volonté plus large de concilier performance et responsabilité. La modernisation de la relation usager ne doit pas se faire au détriment des principes d’accessibilité, d’inclusion ou de respect de l’environnement, et doit donc être en conformité avec les engagements de sobriété numérique et de qualité de service qui figurent dans le programme Services Publics+.
B. Accompagnement des agents et gestion du changement
Les premiers vecteurs de la transformation de la relation usager sont les agents publics, qui doivent être impliqués activement dans ce processus. Leur rôle est incontournable dans l’application concrète des nouveaux dispositifs, ainsi que pour garantir la qualité des interactions avec les usagers.
Les agents doivent ainsi bénéficier d’une formation adaptée aux nouveaux outils, mais aussi aux principes qui guident la modernisation des services publics, à savoir la bienveillance, l’écoute active, la clarté de l’information et le respect du droit à l’erreur. Ces compétences relationnelles sont essentielles pour instaurer une relation usager apaisée, empathique et viable.
Plusieurs dispositifs peuvent être mis en place à cet effet :
- Des modules de formation traditionnels ou immersifs, qui peuvent intégrer des simulateurs basés sur l’intelligence artificielle, pour reproduire des situations d’accueil réalistes et développer les bons réflexes comportementaux ;
- Des campagnes de sensibilisation internes, destinées à faire évoluer les postures et à encourager une culture du service centrée sur l’usager ;
- Des outils de coaching et de suivi individualisé, qui permettent d’accompagner chaque agent selon ses besoins et son rythme d’appropriation des changements.
L’un des principaux enjeux est la gestion des incivilités. Les agents, tout comme leur encadrement, doivent être formés à repérer et à gérer les situations sensibles, dans le respect des personnes et de la réglementation. Il faut aussi que les espaces d’accueil soient aménagés pour constituer des environnements confortables, confidentiels, et favorisant une meilleure expérience pour les usagers comme pour les agents.
L’adoption d’une plateforme de GRU induit elle aussi l’instauration d’un dispositif d’accompagnement, qui passe par :
- La mise en place de formations initiales et continues ;
- Un support technique et fonctionnel à chaque étape du déploiement ;
- Une communication interne claire, transparente, et fédératrice ;
- Une écoute active des retours terrain pour ajuster les pratiques et améliorer les outils.
Ce travail d’accompagnement, s’il est bien mené, permet de sécuriser la transition, de valoriser les compétences des agents, et de garantir que la mise en œuvre de la modernisation de la relation usager est en phase avec les réalités métiers et terrain.
C. Suivi de performance et amélioration continue
Afin qu’elle puisse s’inscrire dans la durée, la modernisation de la relation usager doit impliquer une stratégie de suivi et d’amélioration continue. Mesurer, analyser et ajuster sont des actions indispensables pour évaluer l’efficacité des dispositifs mis en place, identifier les axes de progression, et garantir la pertinence des services à court comme à long terme.
Le point de départ est la mesure de la satisfaction des usagers. Elle permet de recueillir leurs retours et impressions quant à la qualité de l’accueil, la clarté de l’information, ou encore la rapidité de traitement des demandes. Des indicateurs quantitatifs doivent également être utilisés, tels que :
- Le délai moyen de traitement des demandes ;
- Le taux de résolution au premier contact ;
- Le nombre d’interactions évitables grâce à une meilleure orientation.
Les données qui proviennent des outils numériques, qu’il s’agisse des plateformes GRU, des téléservices ou encore des chatbots, sont de précieuses ressources qui permettent de mieux comprendre les parcours usagers, et de repérer les irritants. Les analyser sert à déterminer les améliorations qui sont à apporter, que ce soit au niveau des process, des interfaces, ou des pratiques professionnelles.
L’amélioration continue est aussi indissociable d’une capacité d’adaptation de l’organisation. Les services publics doivent pouvoir faire évoluer leurs procédures internes en fonction des retours terrain, le tout en assurant la continuité des services physiques pour les publics qui doivent y avoir recours, et en renforçant la cohérence entre les canaux pour garantir une expérience homogène.
L’inclusion est un autre impératif, qui implique d’adapter les interfaces, de proposer des formats accessibles, de conserver des guichets d’accueil physique et de garantir un accompagnement humain pour qu’aucun citoyen ne soit lésé.
L’innovation doit quant à elle être insufflée comme une dynamique constante, et être fondée sur des mises à jour régulières des outils, une veille technologique active, ainsi qu’une valorisation des initiatives locales qui améliorent concrètement l’expérience usager.
Cet effort de suivi et d’amélioration continue, lorsqu’il est couplé à une stratégie de sobriété numérique et de responsabilité environnementale, est en parfaite adéquation avec les engagements pris dans le programme Services Publics+. Il permet de faire de la relation usager un véritable levier d’exemplarité, d’innovation, et de confiance dans le service public.
Pour aller plus loin :
La modernisation de la relation usager, en raison de la numérisation des services, implique de disposer d’infrastructures, d’outils et de solutions efficaces, et qui doivent, dans l’optimal, être issus, gérés et hébergés en France et en Europe. Dans la continuité de cet article, nous vous invitons donc à consulter notre dossier consacré à la souveraineté numérique, un véritable impératif de l’indépendance et de la pérennité de nos institutions.